Alors que l’on commémore, ce vendredi 17 octobre (à 17H30 au Pont Saint-Michel à Paris), le cinquante-troisième anniversaire du massacre d’octobre 1961, il nous paraît utile de revenir sur le travail d’Emmanuel Blanchard. Dans son livre La police parisienne et les Algériens (1944-1962), paru en 2011, l’historien restitue les résultats d’une longue enquête sur la police parisienne. Il montre comment, de 1947 à 1958, la préfecture de police, en réponse à ce qu’elle perçoit comme le « problème nord africain », constitue, de façon non encore publique, des unités ciblant spécifiquement les Algériens. Alors que la guerre d’indépendance algérienne s’étend à la métropole en 1957 et 1958, les forces de police s’engagent dans une politique « d’élimination des indésirables ». A l’automne 1961, le préfet Maurice Papon obtient du gouvernement un véritable « chèque en blanc » pour démanteler le FLN et mener une bataille qui débouchera sur la perpétuation d’un massacre colonial au cœur de Paris, le massacre du 17 octobre 1961. Cette enquête historique inédite est précieuse en ce qu’elle permet de réinscrire ce déchaînement de violence exceptionnel dans des généalogies plus longues. En faisant la socio-histoire de l’institution policière et de ses liens avec le gouvernement, en restituant le rôle de Maurice Papon et la responsabilité très claire de Michel Debré et du Général de Gaulle, on voit réfutées les thèses d’un gouvernement politique dépassé, ou celle d’une simple « crise » au sein de la police. Tout en recommandant la lecture du livre dans son entier, nous reproduisons ici son épilogue.
« Les policiers sont devenus les combattants sans merci d’une lutte sournoise et sans merci, car c’est d’une guerre raciale qu’il s’agit. Et voici la conséquence : l’État, lui, est devenu dépendant de sa police – de son armée aussi, de cette armée dont certains organes ont été démesurément développés par leurs fonctions répressives : l’esprit de corps est la source de tout notre malheur comme il l’était déjà du temps de Dreyfus. »
François Mauriac, Le Figaro littéraire, 11 novembre 1961 [1]
En octobre 1961, toutes les conditions de possibilité d’une violence extrême étaient réunies. L’histoire longue des pratiques de police vis-à-vis d’une population racialisée et soumise à une emprise spécifique des forces de l’ordre ; l’état de quasi-belligérance entre une organisation armée et des policiers voulant venger leurs morts ; la désobéissance organisée à un « couvre-feu » qui, sans fondement légal, était le symbole d’une forme de souveraineté policière ; l’atteinte symbolique à la souveraineté nationale défiée par la parade d’une « organisation terroriste » avec laquelle il n’était possible de négocier qu’à condition qu’elle soit défaite ; le format du dispositif de maintien de l’ordre ; la tolérance hiérarchique et politique vis-à-vis de violences quotidiennes et de pratiques extra-légales considérées comme nécessaires ou pour le moins inévitables, sont au nombre des logiques qui permettent d’appréhender ce massacre inscrit dans la situation coloniale.
Ce serait cependant céder à « l’illusion étiologique [2] » que d’expliquer le massacre du 17 octobre 1961 seulement par ces généalogies et ce contexte. Pour que les rafles au faciès dégénèrent en quasi-« pogrom [3] », il a fallu que se mêlent, de façon en apparence paradoxale, les encouragements de la hiérarchie et l’insubordination d’agents subalternes que leurs encadrants laissèrent souvent seuls pour ne pas avoir à les sanctionner. Ces brisures dans la chaîne hiérarchique et cette forme de démission temporaire des autorités policières, qui savaient pouvoir compter sur leurs agents pour que le seul objectif qui valait à leurs yeux – arrêter le maximum d’Algériens afin que force reste à la « loi » – soit atteint, donnèrent la possibilité à chacun des policiers d’utiliser toute la gamme des moyens en sa possession pour gagner la bataille engagée contre le FLN.
Cette enquête ne permet pas de savoir comment les agents s’accommodèrent individuellement de ce chèque en blanc. C’est pourtant au niveau des groupes de référence professionnels (la brigade, l’unité, les quelques collègues habitués à « marcher » ensemble…) que se jouèrent les ajustements, les processus d’alignement [4] (dans la violence effrénée ou, plus rarement semble-t-il, dans une certaine retenue) et l’ensemble des micro décisions qui donnèrent à ce massacre – proche par ses caractéristiques de certains de ceux perpétrés en Afrique du Nord [5] – les contours qu’on lui connaît.
Si des policiers plus nombreux avaient répondu au relâchement des contraintes qui pesaient sur eux autrement que par une forme d’hyperconformisme aux attentes de l’institution, le 17 octobre aurait pu n’être qu’une gigantesque rafle aux mailles trop lâches pour permettre l’arrestation des 12 000 Algériens interpellés ce soir-là. De nouvelles études, des changements d’échelles seraient donc nécessaires pour rendre compte de la diversité des attitudes et des ressorts de l’engagement différentiel dans une répression dont la radicalisation conduisit à des comportements sortant du répertoire policier habituel.
Le « manifeste des policiers républicains [6] » qui dénonçait une « situation de pogrom permanent », l’état de choc de certains délégués du SGP face aux exactions commises par des collègues appartenant parfois au même syndicat démontrent d’ailleurs l’absence d’homogénéité des comportements et des sentiments face au rôle joué par les différentes unités de la police parisienne. Au-delà du seul moment « octobre 1961 », des témoignages indiquent que, même dans les moments et les quartiers les plus durement touchés par l’état de guerre, il y eut des policiers qui se démarquèrent anonymement de leurs collègues et firent connaître leur solidarité avec les Algériens. Une militante du FLN interviewée par Danièle Amrane-Minne évoque des « policiers gentils » et plus particulièrement le cas d’un brigadier du poste de la rue Fleury (18e arr.) qui renseignait les cadres locaux du FLN en affirmant : « C’est normal vous êtes des résistants, moi aussi j’ai fait de la résistance [7] ».
Il s’agissait cependant de cas singuliers et il semble que le mot d’ordre du FLN de braver collectivement le couvre-feu fut avant tout ressenti comme une occasion de régler des comptes, de pouvoir enfin sanctionner collectivement une population dont la présence et la résistance n’avaient cessé de poser « problème », bien avant que les nationalistes algériens ne prennent les policiers pour cibles [8]. Cela explique que le commandement n’eut pas à motiver les troupes, à tel point que pour nombre de policiers il apparaissait a posteriori qu’ils étaient en état de quasi-désobéissance.
Un délégué du SGP témoigna ainsi devant ses collègues syndicalistes : « Il y a eu des moments où le commandement ne pouvait pas s’opposer au personnel, qui ne voulait rien écouter et qui se serait retourné aussi bien contre ses chefs. Je l’ai vu au 3e [district], où un gardien a menacé de son arme son brigadier [9]. » Le déroulement de la manifestation du 13 mars 1958 (au cours de laquelle deux directeurs de la préfecture de police avaient été frappés par des gardiens [10]) ou la manière dont l’affrontement physique était utilisé pour dénouer les conflits entre subordonnés et gradés [11] donne du crédit à une anecdote de prime abord surprenante.
Il ne faudrait pas pour autant en conclure que ce massacre fut le fait d’une base soudée par la violence contre une hiérarchie accusée de ne pas assez la protéger ou de la brider dans ses pratiques de « maintien de l’ordre [12] ». Ce n’était d’ailleurs pas l’interprétation des dirigeants du SGP et pas simplement en raison d’une logique corporatiste qui aurait consisté à tenter de dédouaner les responsabilités des personnels subalternes qu’ils représentaient.
Depuis des mois, le principal syndicat des gardiens n’avait eu de cesse de dénoncer la vacance d’une hiérarchie qui ne faisait pas son travail d’encadrement, d’explication et de recommandation. Il avait aussi alerté la direction de la police municipale sur l’état d’esprit des gardiens et même obtenu que le préfet Papon fasse une tournée des services. Rouve et ses adjoints avaient en effet parfaitement compris que ces silences étaient une manière de conforter les éléments les plus engagés dans le combat activiste et prêts à outrepasser leur mandat habituel. Les sympathies pro-OAS de certains directeurs de la police parisienne étaient d’ailleurs bien connues et ne pouvaient que conforter ces analyses [13].
Le SGP fut ébranlé par le 17 octobre 1961, déchiré entre la justification des pires atrocités par certains de ses délégués et les contributions à un « manifeste des policiers républicains » qui émanait de ses rangs. Piégé par Maurice Papon qui, au nom de la revendication syndicale d’instauration d’un couvre-feu, l’avait enjoint de porter plainte à ses côtés contre les rédacteurs de ce long tract, ces remises en cause ne touchèrent pas l’ensemble de la police parisienne.
Ainsi, les articles sur le « malaise policier » qui se multiplièrent à la fin de l’année 1961 et au début de l’année 1962, doivent être avant tout vus comme un indice de la proximité entre le SGP et certains journalistes [14], et non comme le symptôme d’une crise de l’institution policière. Le 17 octobre 1961 permit au contraire de resserrer les rangs et alors même qu’au début du mois certains pouvaient « sentir venir un nouveau 13 mars [1958] [15] » toute menace sérieuse d’insubordination fut ensuite écartée.
Plus fondamentalement, les autorités politiques eurent certes à gérer le mensonge d’État devant permettre de mettre fin aux protestations nées de l’application à Paris de techniques de maintien de l’ordre jusqu’alors cantonnées à l’empire colonial mais elles ne remirent nullement en cause l’action de la préfecture de police. De Gaulle n’était pas homme à considérer que quelques dizaines de morts étaient un prix à payer trop élevé pour préserver l’autorité symbolique de l’État et affermir sa position dans des négociations qui reprirent quelques jours après le 17 octobre [16].
Il n’y eut nul atermoiement au sommet de l’État : Michel Debré était parfaitement informé par Michel Massenet de la multiplication des violences policières intervenues depuis septembre et fit part au général de Gaulle que « la police parisienne, au cours du mois d’octobre, avant et après les manifestations musulmanes s’est comportée avec brutalité [17]. » Il n’était pourtant pas question de « jeter le trouble » parmi les forces de l’ordre et les velléités du Premier ministre de « s’occuper personnellement de cette affaire » ne furent suivies d’aucun effet.
Dans les années suivantes, ni Michel Debré ni le général de Gaulle ne tarirent d’éloges sur Maurice Papon et ils ne lui reprochèrent d’aucune façon les dispositions mises en oeuvre le 17 octobre 1961. L’affaiblissement de la Fédération de France induit par les internements et les expulsions massives en Algérie furent même portés au crédit du préfet de police qui contribua ainsi à montrer que même si l’État français négociait avec le FLN, il le faisait en position de force et sans y être contraint par les « attentats » perpétrés par les indépendantistes.
Cette reconnaissance de l’action de la police incarnée dans la manière dont l’ensemble des acteurs du massacre d’octobre 1961 furent couverts au plus haut niveau est un des éléments qui explique qu’on ne puisse pas parler de « crise policière » : à cette époque, l’institution policière resta globalement dans ses frontières sectorielles. Ni ses dirigeants, ni les personnels ne cherchèrent à s’approprier des prérogatives propres au champ politique [18], ni même à redéfinir leurs missions au-delà des larges marges de manoeuvre concédées par les gouvernants. Il fut par la suite certes difficile de faire rentrer la police parisienne dans le lit des pratiques des « temps ordinaires » et Maurice Papon eut à faire preuve d’autorité pour faire valoir « qu’il faut faire cette conversion de l’armée en campagne qui passe au régime de garnison ».
Il ajoutait que « c’est toujours assez difficile, c’est toujours très délicat mais ceci est à notre mesure et nous devons, par conséquent maîtriser facilement ce passage [19] ». Explicitant très clairement que les usages inconsidérés de la violence ne seraient plus « couverts » mais donneraient lieu à des « sanctions extrêmement sévères », Maurice Papon reconnaissait pleinement la nécessité et l’utilité passées d’une violence d’État au service de la stratégie gouvernementale de résolution de la « crise algérienne ».
Malgré ce qu’écrivait François Mauriac dans son « bloc-notes » cité en exergue de cet épilogue, les polices métropolitaines [20] ne s’affranchirent donc jamais du cadre politique fixé par le chef de l’État. L’écrivain, qui, lorsqu’il collaborait à L’Express, s’était élevé à plusieurs reprises contre les tortures pratiquées par les polices d’outremer, affirmait pourtant : « La police demeure étrangère [à de Gaulle]. Il la subit comme nous tous [21] ».
Si le chef de l’État et le gouvernement étaient bien dépendants de la police, c’est en pleine connaissance de cause qu’ils lui avaient accordé un chèque en blanc que Maurice Papon honora sans qu’ils eurent à s’en plaindre.
p.-s.
Cet article est l’épilogue du livre d’Emmanuel Blanchard, La police parisienne et les Algériens (1944-1962), Éd. Nouveau Monde Editions, 2011. Lire la présentation.
notes
[1] Ce texte est une réponse de F. Mauriac à un courrier privé de J.-M. Domenach qui lui reprochait son silence sur la répression du 17 octobre 1961. Il est publié dans le cadre du « bloc-notes » de François Mauriac.
[2] « L’illusion étiologique » est, selon M. Dobry, la posture qui consiste à arrêter l’explication des crises à la mise en évidence de leurs « déterminants » et autres « sources historiques », Dobry (1986, p. 48-60).
[3] Selon l’expression utilisée à l’époque par les défenseurs des Algériens (voir supra), mais aussi trente ans plus tard dans les interventions médiatiques de C. Melnik, chargé des questions de sécurité dans le cabinet de M. Debré. Einaudi (2001, p. 12, 27).
[4] Ermakoff (2008).
[5] Outre les manifestations marocaines de décembre 1952, ou algériennes de décembre 1960, il aurait notamment fallu citer les répressions sanglantes de nombreuses grèves en Tunisie de la fi n de l’année 1950 à l’indépendance, où le « service d’ordre, en perpétuelle tension nerveuse, s’accoutuma à tirer et à abattre les manifestants ». Julien (2002, p. 194).
[6] Rédigé par un policier communiste syndiqué au SGP, le tract « Un groupe de policiers républicains déclare » fit l’objet d’une plainte du préfet de police, soutenu par les tous les syndicats de la préfecture de police – y compris le SGP, très divisé sur la question, mais soumis à d’intenses pressions de Papon – pour « diffamation publique envers la police ». House, MacMaster (2008a, p. 185-189).
[7] Amrane-Minne (1994, p. 174).
[8] Le récit de vie de Raoul Letard témoigne de l’excitation qui saisit des services entiers, avides d’en découdre, le 17 octobre 1961.
[9] SGP, conseil syndical mixte (gardiens et gradés), 5 décembre 1961, p. 8.
[10] Voir supra chap. 8 et Blanchard (2011a).
[11] Ces anecdotes sont présentes dans un certain nombre de récits de vie, voir en particulier entretiens avec M. Marcel, op. cit.
[12] Ces logiques furent à l’oeuvre le 14 juillet 1953.
[13] F. Rouve alimentait les articles de L’Express sur le sujet. Voir « La police avec qui ? » article saisi de L’Express, 27 décembre 1961, reproduit in Témoignages et documents, n° 34, janvier 1962.
[14] En particulier, dans le cas des deux articles très informés de Michel Legris, « Le malaise de la police », Le Monde, 11 et 12 janvier 1962.
[15] Conseil syndical des gardiens, 3 octobre 1961, p. 12.
[16] Sur la psychologie du général de Gaulle et ses réactions à la violence d’État, voir Melnik (2010). Pour une analyse de la place du 17 octobre dans les affrontements entre négociateurs français et algériens, House, MacMaster (2008a, p. 178-182).
[17] Note de M. Debré au général de Gaulle, 3 novembre 1961, archives de Sciences Po, 2 DE 30.
[18] Pour reprendre le cadre d’analyse de M. Dobry, il n’y eut donc pas de « désectorisation conjoncturelle de l’espace social », caractéristique des situations de « conjoncture politique fluide », autrement dit des « crises politiques », Dobry (1986, p. 140-150).
[19] Allocution du 3 mai 1963 devant les cadres de la PP, APP HA 88.
[20] Il n’en fut pas de même en Algérie où pour reprendre la main sur des services de police acquis à une OAS qui n’hésitait pas à abattre les policiers qui s’opposait à elle, le ministère de l’Intérieur fut notamment obligé d’envoyer des renforts de métropole, Delarue (1990, 1994).
[21] Le Figaro littéraire, 11 novembre 1961, p. 20.
http://lmsi.net/Sociogenese-d-un-crime-d-etat
———–
17 octobre 1961 : archéologie d’un silence
avant-propos
Le 17 octobre 61, la Fédération de France du FLN appelle les Algériens de la région parisienne à manifester pacifiquement contre le couvre-feu instauré le 5 octobre par le préfet de police, Maurice Papon. 30.000 manifestants face à 7000 policiers, 12.000 arrestations, 3 morts selon le bilan officiel, plus de 300 selon le FLN. Plusieurs dizaines selon les rapports demandés par le gouvernement à la fin des années 90 : les missions Mandelkern (98) et Géronimi (99), ayant eu accès aux documents officiels, n’ont pu que constater qu’un nombre très important en avait disparu.
Le gouvernement gaulliste mène une stratégie d’étouffement. C’est par le silence que Papon répond aux questions de Claude Bourdet à la séance du Conseil de Paris du 27 octobre 61. Roger Frey, ministre de l’intérieur et futur président du Conseil Constitutionnel, rejette une demande de commission d’enquête parlementaire, au motif que des informations judiciaires (toutes clôturées par des ordonnances de non-lieu) sont en cours. Les témoignages rassemblés par les éditions Maspero sont saisis chez le brocheur, avant le dépôt légal : ces livres n’existent tout simplement pas. Vérité-Liberté, Les Temps Modernes etPartisans sont saisis. Les projections d’Octobre à Paris de Jacques Panijel sont interdites ; un film réalisé par la Radio-Télévision Belge est déprogrammé, les pellicules disparaissent. La presse communiste (Libération et L’Humanité) fait état des violences policières, mais renonce à publier in extenso des témoignages, pour éviter la saisie. Le Monde et Le Figaro s’indignent des « violences à froid sur les manifestants arrêtés », mais « comprennent les brutalités policières à chaud ».
La suite du Dossier : http://www.vacarme.org/article44.html
———-
la police parisienne et les Algériens au cours des années 1958 à 1962, par Jean-Luc Einaudi
« En l’an 2000, la préfecture de police de Paris a célébré son bicentenaire. A cette occasion a été écrit et publié un petit ouvrage relatant l’histoire de la préfecture de police vue par elle-même. Réalisé sous la direction (scientifique, paraît-il) de monsieur Claude Charlot, chef du service des archives et du musée de la préfecture de police, il s’intitule La préfecture de police au service des Parisiens et est sous-titré Fidèle à ses traditions pour préparer l’avenir. Tout un programme ! »
Ainsi débute un petit livre de 86 pages intitulé Les silences de la police que Jean-Luc Einaudi et Maurice Rajsfus ont publié en octobre 2001 [1]. Il s’agissait pour eux d’aborder deux épisodes de l’histoire contemporaine “oubliés” dans le fascicule officiel : la rafle du Vél’ d’Hiv est expédiée en à peine deux lignes : “la police parisienne fut sollicitée pour la grande rafle qui groupa, au vélodrome d’Hiver, des milliers de Juifs, les 16 et 17 juillet 1942”, et le massacre des Algériens du 17 octobre 1961 est complètement occulté.
Nous reprenons ci-dessous le dernier chapitre des Silences de la police où Jean-Luc Einaudi évoque le comportement de la police parisienne par rapport aux Algériens pendant la guerre d’Algérie.
« Constamment à pied d’œuvre pour assurer la paix publique. »
« La police fut constamment à pied d’œuvre pour assurer la paix publique » : c’est par ces mots que la brochure de la préfecture de police conclut et résume l’action de celle-ci au cours des années de la guerre d’Algérie. C’est, sans conteste, un certificat de bonne conduite qui lui est ainsi décerné. M. Massoni, préfet de police de l’an 2000, félicite ainsi M. Papon, son prédécesseur. Quoi de plus noble, n’est-ce pas, que « la paix publique » ? On nous précise toutefois : « Cette période agitée se caractérise par un engagement permanent des forces de l’ordre, émaillé de quelques épisodes dramatiques comme la tragédie du métro Charonne. »
« Tragédie » ? Certes, c’en fut une pour les huit manifestants morts ce 8 février 1962 au métro Charonne. Mais, par la neutralité de ce mot, on dissimule délibérément les circonstances de ces morts et l’identité de ceux qui en furent les auteurs. Comme on ne peut plus reprendre ouvertement la version mensongère de Papon, alors préfet de police, selon qui ces huit victimes seraient mortes accidentellement par asphyxie ou infarctus du myocarde, on parle de « tragédie » comme il le fit d’ailleurs lui-même en parlant de « tragique événement ». Or, c’est de huit crimes qu’il s’agit, perpétrés par des policiers d’une compagnie de district de la préfecture de police. Huit manifestants massacrés sauvagement, sans défense, par des fonctionnaires de police, à l’issue d’une manifestation contre les crimes terroristes de l’OAS. Les policiers auteurs de ces crimes furent protégés par leur hiérarchie et n’ont jamais fait l’objet de poursuites.
Quant au massacre du 17 octobre 1961, il n’existe tout simplement pas. La préfecture de police de l’an 2000 est fidèle dans le mensonge à celle de 1961.
Avant d’en venir aux années de la guerre d’Algérie, rappelons d’abord une autre tuerie dont il n’existe nulle trace non plus dans la mémoire officielle de la PP : le 14 juillet 1953. Le préfet de police s’appelle alors Jean Baylot. C’est sous son règne qu’ont lieu des réintégrations de policiers révoqués à la Libération et que, parallèlement, sont révoqués d’anciens résistants suspectés d’être communistes. Maurice Papon est secrétaire général de la préfecture de police. Ce jour-là, à l’issue d’une manifestation du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) de Messali Hadj, six Algériens et un Français sont tués, place de la Nation, par les balles de la police. Il n’y a pas alors de guerre en Algérie ; il s’agit simplement d’un épisode supplémentaire dans la tradition de répression policière sanglante, en France, contre les Algériens.
13 mars 1958 : dans la matinée, 7.000 policiers manifestent dans la cour de la préfecture de police. Ils protestent contre le retard apporté au paiement de leur prime de risque. À cette époque, ils ne sont pas encore visés par des attentats du FLN. Des policiers bloquent la circulation et, dans l’après-midi, deux mille d’entre eux se dirigent en manifestant vers la Chambre des députés. On entend crier : « Sales Juifs ! » Le député Jean-Marie Le Pen tente de les faire entrer dans la Chambre et les harangue. Des policiers crient : « Sales Juifs ! À la Seine ! Mort aux fellaghas ! » Le directeur de la police municipale est frappé au visage. « Nous foutrons une grenade au Palais-Bourbon », promettent certains.
Le lendemain, sur proposition du ministre de l’Intérieur, Maurice Bourgès-Maunoury, Maurice Papon est nommé préfet de police. Il a pour mission de reprendre en mains la préfecture de police. Il se trouve alors en Algérie, à Constantine, où depuis deux ans il assure les fonctions d’inspecteur général pour l’administration en mission extraordinaire (IGAME) pour l’Est algérien. Zones interdites, camps de regroupement, tortures, exécutions sommaires : telle est la réalité de la guerre qu’il supervise là-bas. Au cours des années qui vont suivre, il va mettre en œuvre à Paris et dans le département de la Seine des méthodes généralisées en Algérie.
Bientôt, c’est la chute de la IVe République. De Gaulle maintient Papon comme préfet de police. Il crée les compagnies de district, spécialisées dans la répression, qui deviennent le lieu de passage obligatoire pour les nouvelles recrues. On y trouve des anciens d’Indochine, qui en forment l’ossature, et de plus en plus de jeunes qui reviennent d’Algérie.
Le 25 août 1958 a lieu une offensive du FLN sur le territoire métropolitain. Trois policiers sont tués, boulevard de l’Hôpital, devant l’annexe de la préfecture de police, un autre devant la cartoucherie de Vincennes. Le commissariat du XIIIe est mitraillé.
Le 28 août, le préfet de police organise des rafles massives d’Algériens, à Paris et en banlieue. Plus de cinq mille sont internés dans l’ancien hôpital Beaujon, au gymnase Japy, et au Vél’ d’Hiv… La préfecture de police de 1961 est dans la continuité de celle de 1942 : Papon a gardé ses réflexes. La journaliste Madeleine Rifaud, ancienne résistante FTP sous l’occupation nazie, écrit alors dansL’Humanité : « Un camp de concentration raciste est ouvert en plein Paris depuis deux jours. On n’a même pas eu la pudeur de choisir un lieu qui ne rappelle rien aux patriotes qui célèbrent actuellement l’anniversaire de la libération de Paris. » Le préfet de police décrète un couvre-feu pour les « travailleurs nord-africains ». Quelques voix d’anciens résistants s’élèvent pour dénoncer ces mesures, demandent une commission d’enquête pour faire la lumière sur les violences policières commises en ces circonstances. La préfecture de police parle d’« allégations mensongères ». Dès cette époque, des policiers se vantent de jeter des Algériens à la Seine.
La répression anti-FLN prend le caractère d’une répression collective anti-algérienne. En janvier 1959 est créé le centre d’identification de Vincennes (CIV), qui relève de l’autorité du préfet de police. Les Algériens raflés à Paris et dans le département de la Seine y sont conduits pour vérifications d’identité mais peuvent aussi y être « assignés à résidence » sur décision du préfet. Ces rafles sont fréquemment l’occasion de violences. La pratique des « comités d’accueil » se répand : les Algériens raflés passent entre deux rangs de policiers qui les frappent à coups de crosse, de pied, de poing, de matraque, de cravache, de planche, de ceinturon… Des disparitions ont lieu.
En 1960, la force de police auxiliaire entre en action. Cette police supplétive, qui relève du service de coordination des affaires algériennes de la préfecture de police, agit sous les ordres du préfet de police et est encadrée par des militaires. Son chef est le capitaine Montaner. Ses membres sont des Algériens qui, pour des raisons diverses, ont des comptes à régler avec le FLN mais certains ont été enrôlés de force en Algérie. La FPA est basée au fort de Noisy, à Romainville. Elle comptera environ 600 membres à l’automne 1960. La FPA s’installe d’abord dans le XIIIe arrondissement de Paris, où elle réquisitionne des hôtels. Les supplétifs de la préfecture de police font régner la terreur. La torture est pratiquée notamment au 9, rue Harvey et au 208, rue du Château-des-Rentiers. L’usage de la torture est la véritable raison d’être de cette milice qui agit hors de toutes règles légales. La FPA pratique notamment le supplice de la bouteille : le prisonnier est assis sur une bouteille et on lui appuie sur les épaules jusqu’à empalement. L’électricité est également employée. Des disparitions ont lieu. La FPA étend son action dans le XVIIIe arrondissement où trois hôtels sont réquisitionnés, rue de la Goutte-d’Or. Elle intervient également en banlieue et notamment dans les bidonvilles de Nanterre. Des voix s’élèvent contre ces crimes que nie la préfecture de police. Témoignage chrétien écrit : « Il ne nous est pas possible de rester muets quand, dans notre Paris, des hommes ressuscitent les méthodes de la Gestapo. »
A la fin du mois d’août 1961, le FLN décide la reprise des attentats contre des policiers. Onze d’entre eux sont tués et dix-sept blessés à Paris et dans la banlieue de la fin août au début octobre. Ces attentats ont pour effet de répandre la peur dans les rangs de la police parisienne mais aussi de décupler le désir de vengeance et la haine contre l’ensemble d’une communauté. Tout au long du mois de septembre, la répression frappe durement la population algérienne. Dans la pratique, cette répression, massive, est basée sur l’apparence physique. Est suspecte toute personne présentant le faciès supposé de l’Algérien. Les rafles dans les rues, les descentes dans les hôtels sont quotidiennes et s’accompagnent d’humiliations et de violences. Les arrestations ont lieu jusque sur les lieux de travail. La nuit, des policiers conduisent des passants raflés au bord de la Seine ou de canaux, leur lient les mains, les assomment et les jettent à l’eau dans le but de les noyer. Des Marocains et des Tunisiens sont également victimes de ces activités criminelles.
Un rapport, réalisé alors par un prêtre de la Mission de France, le père Joseph Kerlan, relate des faits reflétant fidèlement le climat quotidien :
« Un vieil Algérien sort d’un café vers 22 heures. Sans raison apparente, sans même un contrôle d’identité, il est emmené au poste (Saint-Denis). Sa montre est jetée à terre et piétinée. Ses vêtements sont déchirés. On lui ordonne de mettre les mains sur la tête et un policier le bourre de coups de poing au foie, à l’estomac, dans les côtes. Sous la douleur, il tente de se protéger de ses mains. L’agent l’invite à remettre les mains sur la tête, et les coups recommencent à pleuvoir. Trois semaines après, il souffre encore des coups reçus […] »
« Une voiture de police… un Algérien… L’Algérien, rentrant du travail, est rejoint par la voiture. Il doit présenter ses papiers après les sommations les bras levés.
Un policier : “Il a un permis de conduire. On le déchire ? »
Un autre policier : “Non, laissons-le.”
L’Algérien : “J’ai aussi ma carte d’ancien combattant.”
Un policier : “On s’en fout de ta carte…”
Un policier : “On l’embarque ?”
Un policier : “Viens avec nous faire une promenade.”
« L’Algérien monte dans le fourgon et subit le même manège… ou jeu des policiers. Plus tard, il sera débarqué dans un autre quartier de Paris, sans plus de formalité, prêt à se faire reprendre une, cinq ou dix fois pour recommencer ainsi la même comédie tragique, ne sachant jamais comment cela finira […] »
« Dans le XIIIe, un Algérien est arrêté pour un contrôle d’identité par une patrouille. Formalités habituelles, puis il est relâché, après que les policiers ont, devant lui, déchiré ses papiers. Il se présente aussitôt au commissariat pour en réclamer d’autres. Après avoir donné ses renseignements, il lui est demandé de revenir dans trois mois… le condamnant ainsi à vivre pendant ce temps en « hors-la-loi ». Un peu partout, il est question de papiers déchirés, soit les cartes d’identité, les fiches de paie, ou les feuilles d’allocations familiales[…] »
« Le jeudi 5 octobre une jeune femme algérienne, madame X, me raconte ce fait : il y a quelques jours, un soir, des policiers en civil ont pris quatre Algériens de Gennevilliers. Ils leur ont enlevé leurs papiers puis les ont déchirés. Après ça, les policiers ont battu ces hommes puis les ont descendus à la mitraillette et jetés dans la Seine. L’un des quatre Algériens a été seulement blessé. Il a réussi à se tenir à la berge et à déjouer les policiers qui sont restés un bon moment au bord de la Seine afin de se rendre compte que les Algériens étaient bien morts. Quand les policiers sont partis, il a réussi à nager, à sortir de l’eau et à rentrer chez lui. À la date où ce fait m’est raconté, cet homme était soigné à l’hôpital X. Et madame ajoutant : “Quand mon mari tarde à rentrer le soir, j’ai toujours peur.”
Le samedi 7 octobre, je rencontre X et lui demande s’il a entendu parler de ce fait. Il me le confirme en ajoutant : “Parmi les quatre Algériens, il y avait un copain à moi. Il travaillait à la SKF et a été pris en revenant de son travail — à la SKF, la dernière équipe sort à 11 heures du soir. Un autre a été pris avenue H.-Barbusse. Celui qui a réussi à s’en tirer habite à X” (pour sa sécurité nous ne pouvons mentionner son adresse). »
À cette même époque, l’union régionale parisienne de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) réalise également un document. Il est intitulé Face à la répression. De nombreux faits y sont rapportés :
« A. P., un gardien de la paix règle la circulation à la sortie d’une école. Un Nord-Africain, à mobylette, s’arrête au signal à côté des voitures. L’agent se dirige vers lui et lui demande ses papiers, que l’interpellé lui tend. L’agent les prend : coup à l’estomac. Il les examine, les trouve parfaitement en règle et les rend à l’intéressé en lui administrant une violente paire de gifles devant des dizaines de personnes et d’enfants. […] »
« Des contrôles, avec fouilles, suivis ou non de ramassage sont effectués systématiquement les jours de paye, le plus souvent à proximité de la sortie des usines (Boulogne-Drancy). Les sommes d’argent dont sont porteurs les Algériens sont confisquées sur le champ, même si la feuille de paye en légitime le port. Il semble que cet argent reste entre les mains des auteurs de l’opération […] »
« De nombreuses “disparitions” d’Algériens sont signalées par leurs camarades. Des hommes arrêtés ont été jetés à la Seine après avoir été assommés et, parfois, ficelés. Certains ont réussi à s’en sortir. Des Algériens sont priés d’aller identifier à la morgue le corps de leurs camarades repêchés en aval de Paris.[…] »
« Au cours de la semaine du 18 au 24 septembre à V., cinq Algériens se rendant à leur hôtel ont été emmenés en car et jetés à la Seine. Un y est resté.[…] »
C’est dans ce climat que, le 2 octobre, lors des obsèques d’un policier tué par le FLN, le préfet de police proclame, dans la cour de la préfecture : « Pour un coup reçu, nous en porterons dix ! » Cet appel est un encouragement à tuer des Algériens et est compris aussitôt comme tel. Le même jour, en visite au commissariat de Montrouge, le préfet de police déclare aux policiers présents : « Vous devez être subversifs aussi dans la guerre qui vous oppose aux autres. Vous serez couverts, je vous en donne ma parole. »
Dans la nuit même et les jours suivants, de nouveaux cadavres d’Algériens sont découverts.
Le 5 octobre, par un communiqué, le préfet de police annonce l’instauration d’un couvre-feu qui s’applique à tous ceux qu’il qualifie tour à tour de « travailleurs musulmans algériens », de « Français musulmans », ou encore de « Français musulmans d’Algérie ». Ce couvre-feu raciste, anticonstitutionnel, interdit aux 150.000 Algériens de la région parisienne de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue, particulièrement entre 20h30 et 5h30. À l’époque, ils sont pourtant officiellement considérés comme Français et disposent d’une carte d’identité française.
Avec l’instauration de ce couvre-feu, les violences policières, devenues banales, se poursuivent et les crimes se multiplient. Officiellement, à la préfecture de police et au ministère de l’Intérieur, on ment en affirmant que les cadavres découverts sont dus à des « règlements de comptes entre Algériens », qu’il s’agit de victimes du FLN.
La fédération de France du FLN appelle l’ensemble des Algériens de la région parisienne, hommes, femmes, enfants, à manifester contre ce couvre-feu, le mardi 17 octobre 1961. Ces manifestations devront être impérativement pacifiques. Aucun manifestant ne devra être porteur d’un quelconque objet pouvant être considéré comme une arme.
Le préfet de police dispose de 7.000 gardiens de la police parisienne, de 1.400 CRS et gendarmes mobiles pour empêcher ces rassemblements.
Le 17 octobre 1961, en début de soirée, les Algériens commencent à affluer vers Paris. Leur nombre sera évalué entre 30.000 et 40.000. Les voies d’accès à la capitale, les gares, les stations de métro, les portes de Paris, sont bloquées par des policiers. Les bus sont arrêtés à des barrages et les passagers désignés par les policiers doivent en descendre. Les rafles racistes commencent. De nombreux travailleurs algériens, mais aussi marocains, tunisiens, voire espagnols ou italiens, qui rentrent chez eux, ignorant tout des manifestations, sont raflés en raison de leur apparence. La violence de nombreux policiers éclate. L’attitude de ces fonctionnaires n’est pas celle d’hommes qui ont peur mais plutôt d’individus qui donnent libre cours à leur haine. Il n’y a pas de bagarres ; les hommes arrêtés ne sont pas menaçants. Comme les cars de police ne suffisent plus à transporter les personnes raflées, le préfet de police réquisitionne des autobus de la RATP (avec leurs conducteurs) qui reviendront couverts de sang dans leurs dépôts. Les victimes des rafles sont conduites dans des commissariats de Paris et de la banlieue, dans la cour de la préfecture de police, au Palais des Sports de la Porte de Versailles, au stade de Coubertin.
De fausses nouvelles circulent tout au long de la soirée sur les ondes radio de la police, exacerbant la haine, sans être démenties par le préfet de police et son état-major. De nombreux policiers frappent avec la volonté de tuer.
En dépit des rafles, des cortèges d’Algériens réussissent à se former. Une manifestation de 4.000 à 5.000 personnes parcourt pacifiquement les Grands Boulevards, sans aucun incident, de la République à l’Opéra. Là, le cortège, ne pouvant plus avancer, fait demi-tour, suivi par des cars de police. À la hauteur du cinéma Le Rex, des policiers ouvrent froidement le feu sur la foule, puis chargent et frappent, faisant des morts.
Au pont de Neuilly, des policiers et supplétifs de la FPA ouvrent le feu sur les manifestants. Il y a également des morts.
Du haut des ponts de Paris et de la banlieue, des Algériens sont précipités dans la Seine et noyés. C’est notamment le cas au pont Saint-Michel, à quelques dizaines de mètres de la préfecture de police et du Palais de Justice. Les policiers et gendarmes qui commettent ces crimes agissent avec la certitude de l’impunité.
Dans la cour même de la préfecture de police, les Algériens, entassés, subissent de froides violences. Des policiers passent des cordes autour des cous de leurs victimes et serrent jusqu’à ce qu’elles perdent connaissance. Dans la nuit, un véritable massacre se déroule dans la cour de la préfecture de police, faisant plusieurs dizaines de victimes.
Au Palais des Sports, puis au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, les Algériens raflés, souvent déjà blessés, sont systématiquement victimes des « comités d’accueil ». À l’intérieur de ces lieux, les violences se poursuivent, des prisonniers sont torturés. Des hommes vont ainsi mourir jusqu’à la fin de la semaine. Des scènes semblables se déroulent au stade de Coubertin.
Dans la nuit du 17 octobre, la préfecture de police donne laversion officielle mensongère des événements : « Des coups de feu ont été tirés contre les membres du service d’ordre qui ont riposté. À 22 heures, on dénombrait deux morts et plusieurs blessés algériens. » Il n’y a aucun policier blessé par balle.
Les rafles, violences, noyades se poursuivront les jours suivants. Durant des semaines, on découvrira des cadavres non identifiés et l’on retrouvera des corps au fil de l’eau. Le résultat de ce massacre peut être évalué à au moins deux cents morts.
Tout sera mis en œuvre, par le préfet de police, le ministre de l’Intérieur, Roger Frey, le Premier ministre, Michel Debré, et le président de la République, Charles de Gaulle, pour que l’ampleur de ce crime soit dissimulée.

- Photo : Elie Kagan
Mais, le 31 octobre 1961, des policiers publient un texte anonyme pour dénoncer les crimes qui viennent d’être commis. Le texte s’intitule Un groupe de policiers républicains déclare… On y lit notamment ceci :
« Ce qui s’est passé le 17 octobre 1961 et les jours suivants contre les manifestants pacifiques, sur lesquels aucune arme n’a été trouvée, nous fait un devoir d’apporter notre témoignage et d’alerter l’opinion publique. […] Tous les coupables doivent être punis. Le châtiment doit s’étendre à tous les responsables, ceux qui donnent les ordres, ceux qui feignent de laisser faire, si haut placés soient-ils. Nous nous devons d’informer. […]
Parmi les milliers d’Algériens emmenés au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, des dizaines ont été tués à coups de crosse et de manche de pioche par enfoncement du crâne, éclatement de la rate ou du foie, brisure des membres. Leurs corps furent piétinés sous le regard bienveillant de M. Paris, contrôleur général. […]
À l’une des extrémités du pont de Neuilly, des groupes de gardiens de la paix, à l’autre des CRS, opéraient lentement leur jonction. Tous les Algériens pris dans cet immense piège étaient assommés et précipités systématiquement dans la Seine. Il y en eut une bonne centaine à subir ce traitement. […]
La petite cour, dite d’isolement, qui sépare la caserne de la Cité de l’hôtel préfectoral était transformée en un véritable charnier. Les tortionnaires jetèrent des dizaines de leurs victimes dans la Seine qui coule à quelques mètres pour les soustraire à l’examen des médecins légistes. Non sans les avoir délestées, au préalable, de leur montre et de leur argent. M. Papon, préfet de police, et M. Legay, directeur général de la police municipale, assistaient à ces horribles scènes. Dans la grande cour du 19-Août plus d’un millier d’Algériens était l’objet d’un matraquage intense que la nuit rendait encore plus sanglant.[…]
Ces quelques faits indiscutables ne sont qu’une faible partie de ce qui s’est passé ces derniers jours, de ce qui se passe encore. Ils sont connus dans la police municipale. Les exactions des harkis, des brigades spéciales des districts, de la brigade des agressions et violences ne sont plus des secrets. Les quelques informations rapportées par les journaux ne sont rien au regard de la vérité.[…]
Nous ne signons pas ce texte et nous le regrettons sincèrement. Nous constatons, non sans tristesse, que les circonstances actuelles ne le permettent pas. Nous espérons pourtant être compris et pouvoir révéler nos signatures sans que cela soit une sorte d’héroïsme inutile. […] »
Le préfet de police fait rechercher, en vain, les auteurs de ce texte. L’Inspection générale des services, chargée de l’enquête, aboutit à la conclusion qu’il s’agit bien de policiers en constatant la précision des informations. Il faudra attendre trente ans pour que le principal auteur se dévoile. Il se nomme Émile Portzer. Ancien résistant du réseau Front national de la police sous l’Occupation, il a voulu rester fidèle à son combat d’alors en dénonçant ces crimes et leurs responsables. Il a rassemblé des témoignages de policiers, témoins des faits et écœurés, pour rédiger ce texte. Il viendra témoigner en ma faveur, en février 1999, lors du procès que m’intentera l’ancien préfet de police Papon. Le 1er janvier 1962, dans un ordre du jour aux fonctionnaires de préfecture de police, le préfet de police déclare : « Le 17 octobre, vous avez remporté, au prix de durs sacrifices depuis longtemps consentis, la victoire sur le terrorisme algérien… Vos intérêts moraux ont été défendus avec succès, puisque l’intention des adversaires de la préfecture de police de mettre en place une commission d’enquête a échoué. »
Le 8 février 1962 a lieu le massacre de Charonne.
La préfecture de police avait été « constamment à pied d’œuvre pour assurer la paix publique », pour reprendre l’infâme formule employée en l’an 2000 sous M. Massoni.
Il ne faut pas s’étonner, dans ces conditions, si celui-ci s’est durant si longtemps opposé à ce que je puisse avoir accès aux archives de la préfecture de police sur cette période, en dépit des déclarations du Premier ministre demandant à faciliter le travail des chercheurs.
Ce n’est que contraint et forcé, sous la pression d’un mouvement d’opinion en faveur de la recherche de la vérité, qu’il a dû finalement m’y autoriser au mois de décembre 2000.
On attend maintenant du Premier ministre qu’il se prononce clairement sur l’histoire de la préfecture de police vue par elle-même et avalisée par son ancien ministre de l’Intérieur.
Notes
[1] Jean-Luc Einaudi et Maurice Rajsfus, Les silences de la police, éditions l’Esprit frappeur, 86 pages, 3 euros, octobre 2001.
http://ldh-toulon.net/la-police-parisienne-et-les,4658.html
————-
Claude Bourdet : “est-il vrai, monsieur le préfet de police … ?”
Il aura fallu attendre 51 ans pour que la République reconnaisse la « sanglante répression » de la manifestation pacifique des Algériens qui revendiquaient le droit à l’indépendance de leur pays. Le 17 octobre prochain, plusieurs rassemblements commémoreront cette page, l’une des plus sombres de l’histoire de notre pays.
La violence de la répression suscita des protestations de la part d’un certain nombre d’élus, et notamment d’élus engagés contre la guerre d’Algérie, comme Claude Bourdet, ancien membre du Conseil National de la Résistance, un des fondateurs de France-Observateur et du PSU. Élu au Conseil de Paris, il interpella le Préfet de Police Maurice Papon, le 27 octobre 1961. Nous reprenons ci-dessous la question qu’il lui posa, mais qui n’obtint pas de réponse.
« Monsieur le préfet de police … »
Conseil de Paris, 27 octobre 1961 [1]
J’en viens d’abord aux faits. Il n’est guère besoin de s’étendre. Parlerai-je de ces Algériens couchés sur le trottoir, baignant dans le sang, morts ou mourants, auxquels la Police interdisait qu’on porte secours ? Parlerai-je de cette femme enceinte, près de la place de la République, qu’un policier frappait sur le ventre ? Parlerai-je de ces cars que l’on vidait devant un commissariat du quartier Latin, en forçant les Algériens qui en sortaient à défiler sous une véritable haie d’honneur, sous des matraques qui s’abattaient sur eux à mesure qu’ils sortaient ? J’ai des témoignages de Français et des témoignages de journalistes étrangers. Parlerai-je de cet Algérien interpellé dans le métro et qui portait un enfant dans ses bras ? Comme il ne levait pas les bras assez vite, on l’a presque jeté à terre d’une paire de gifles. Ce n’est pas très grave, c’est simplement un enfant qui est marqué à vie !
Je veux seulement mentionner les faits les plus graves et poser des questions. Il s’agit de faits qui, s’ils sont vérifiés, ne peuvent pas s’expliquer par une réaction de violence dans le feu de l’action. Ce sont des faits qui méritent une investigation sérieuse, détaillée, impartiale, contradictoire.
D’abord, est-il vrai qu’au cours de cette journée, il n’y ait pas eu de blessés par balle au sein de la Police ? Est-il vrai que les cars radio de la Police aient annoncé au début de la manifestation dix morts parmi les forces de l’ordre, message nécessairement capté par l’ensemble des brigades… et qui devait donc exciter au plus haut point l’ensemble des policiers ? C’était peut-être une erreur, c’était peut-être un sabotage, il faudrait le savoir ; et peut-être, d’autre part, n’était-ce pas vrai. C’est pour cela que je veux une enquête.
De même, est-il vrai qu’un grand nombre des blessés ou des morts ont été atteints par des balles du même calibre que celui d’une grande manufacture qui fournit l’armement de la Police ? Qu’une grande partie de ces balles ont été tirées à bout portant ? Une enquête dans les hôpitaux peut donner ces renseignements. Il est clair que ce n’est pas n’importe quelle enquête et que ceux qui la feraient devraient être couverts par son caractère officiel et savoir qu’ils ne risqueraient rien en disant la vérité.
Et voici le plus grave : est-il vrai que dans la « cour d’isolement » de la Cité, une cinquantaine de manifestants, arrêtés apparemment dans les alentours du boulevard Saint-Michel, sont morts ? Et que sont devenus leurs corps ? Est-il vrai qu’il y a eu de nombreux corps retirés de la Seine ? Dans les milieux de presse, et pas seulement dans les milieux de la presse de gauche, dans les rédactions de la presse d’information, on parle de 150 corps retirés de la Seine entre Paris et Rouen. C’est vrai ou ce n’est pas vrai ? Cela doit pouvoir se savoir. Une enquête auprès des services compétents doit permettre de le vérifier. Cela implique, ai-je dit, non pas une enquête policière ou administrative, c’est-à-dire une enquête de la Police sur elle-même, mais une enquête très large, avec la participation d’élus.
J’en viens maintenant au propos qui est pour moi l’essentiel : celui qui vous concerne directement, Monsieur le Préfet de Police. Mon projet n’est pas de clouer au pilori la Police parisienne, de prétendre qu’elle est composée de sauvages, encore qu’il y ait eu bon nombre d’actes de sauvagerie. Mon projet est d’expliquer pourquoi tant d’hommes, qui ne sont probablement ni meilleurs, ni pires qu’aucun de nous, ont agi comme ils l’ont fait. Ici je pense que, dans la mesure où vous admettrez partiellement ces faits, vous avez une explication. Elle a d’ailleurs été donnée tout à l’heure : elle réside dans les attentats algériens, dans les pertes que la Police a subies.
Il s’agit seulement d’expliquer, sur le plan subjectif, l’attitude de la Police, cette explication est, en partie, suffisante. Nous nous sommes inclinés assez souvent ici sur la mémoire des policiers tués en service commandé pour le savoir, mais cela n’explique pas tout. Et surtout, ces explications subjectives ne suffisent pas. Le policier individuel riposte lorsqu’il est attaqué, mais il faut voir les choses de plus loin. Ce qui se passe vient d’une certaine conception de la guerre à outrance menée contre le nationalisme algérien. Ici on peut me répondre : « Auriez-vous voulu que nous laissions l’ennemi agir librement chez nous ? Et même commettre des crimes impunément ? » Sur ce plan, la logique est inévitable : l’ennemi est l’ennemi ; il s’agit de le briser par tous les moyens, ou presque. Mais l’ennemi répond alors de la même façon, et on arrive là où nous sommes aujourd’hui.
Il était impossible qu’il y ait une guerre à outrance en Algérie et qu’il ne se passe rien en France. Mais ce que je dis – et cela me semble vérifié pour tout ce qu’on a dit ici, à droite, sur la puissance du FLN en France, et sur la menace qu’il représente -, c’est qu’il aurait pu rendre la situation infiniment plus grave qu’il ne l’a rendue.
Les dirigeants algériens ont agi non pas en vertu de sentiments d’humanité mais dans leur propre intérêt, parce qu’ils voulaient pouvoir organiser les Algériens en France, parce qu’ils voulaient « collecter » comme on l’a dit et cela, vous le savez bien, en général beaucoup plus par le consentement que par la terreur. Il y avait là aussi, probablement, l’influence d’un certain nombre de cadres algériens, en particulier de ces cadres syndicaux de l’UGTA [2] très enracinés dans le mouvement syndical français, très proches de la population métropolitaine, hostiles au terrorisme. Ce sont malheureusement eux, justement, parce qu’ils étaient connus, repérés, voyants, qui ont été les premiers arrêtés, souvent déportés en Algérie, et on ne sait pas malheureusement, vous le savez, ce que ceux-là sont devenus.
Vous répliquerez qu’il y a eu, dès le début de la guerre, des règlements de compte entre Algériens, des liquidations de dénonciateurs, etc., c’est-à-dire des crimes que la Police ne pouvait pas tolérer, quelle que fût sa politique. Oui, mais il y a, pour la Police, bien des façons d’agir et dans les premiers temps, on n’a pas vu se produire, du côté policier, les violences extrêmes qui sont venues ultérieurement. Ce que je dis, c’est qu’à un certain moment, on a estimé que cette action de la Police ne suffisait pas.
On a estimé qu’il fallait qu’à la guerre à outrance menée contre le FLN en Algérie corresponde la guerre à outrance menée contre le FLN en France. Le résultat a été une terrible aggravation de la répression, la recherche par tous les moyens du « renseignement », la terreur organisée contre tous les suspects, les camps de concentration, les sévices les plus inimaginables et la « chasse aux ratons ».
Je dis, Monsieur le Préfet de Police, que vous-même avez particulièrement contribué à créer ainsi, au sein d’une population misérable, épouvantée, une situation où le réflexe de sécurité ne joue plus. Je dis que les consignes d’attentats contre la Police étaient bien plus faciles à donner dans un climat pareil de désespoir. Je dis que même si de telles consignes n’existaient pas, le désespoir et l’indignation suffisaient souvent à causer des attentats spontanés, en même temps qu’à encourager ceux qui, au sein du FLN, voulaient en organiser. Je dis qu’on a alimenté ainsi un enchaînement auquel on n’est pas capable de mettre fin.
Je pense, Monsieur le Préfet de Police, que vous avez agi dans toute cette affaire exactement comme ces chefs militaires qui considèrent que leur propre succès et leur propre mérite se mesurent à la violence des combats, à leur caractère meurtrier, à la dureté de la guerre. C’était la conception du général Nivelle au cours de l’offensive du Chemin des Dames, et vous savez que l’Histoire ne lui a pas été favorable. C’est cette conception qui a été la vôtre à Constantine et celle que vous avez voulu importer dans la région parisienne, avec les résultats que l’on sait. Maintenant, vous êtes pris à votre propre jeu et vous ne pouvez pas vous arrêter, même en ce moment, à une époque où la paix paraît possible. La terreur à laquelle la population algérienne est soumise n’a pas brisé la menace contre vos propres policiers, bien au contraire. J’espère me tromper, j’espère que vous n’aurez pas relancé, d’une manière encore pire, l’enchaînement du terrorisme et de la répression.
Car, enfin, il n’était pas condamnable, il était excellent que le FLN cherche, lui, à sortir de cet engrenage par des manifestations de rue, des manifestations dont un grand nombre de gens ont dit qu’elles étaient, à l’origine, pacifiques. Nous aurions dû comprendre, vous auriez dû comprendre, que c’était là l’exutoire qui permettrait au désespoir de ne pas se transformer en terrorisme. Au lieu de cela, vous avez contribué à créer une situation pire. Vous avez réussi, et peut-être certains s’en félicitent-ils, à dresser contre les Algériens, il faut le dire, une partie importante de la population parisienne qui ne comprend pas évidemment pourquoi ces Algériens manifestent. Elle n’est pas algérienne, cette population, elle ne vit pas dans les bidonvilles, sa sécurité de tous les instants n’est pas menacée par les harkis, etc. Alors, évidemment, « que viennent faire dans les rues ces Algériens ? Leur attitude est incompréhensible ! »
Je dis, Messieurs les Préfets, mes chers collègues, que loin de chercher à réprimer l’agitation politique des Algériens, nous devons dans cette perspective de négociation, de paix, qui s’ouvre enfin, même si c’est trop tard – nous devons chercher à légaliser l’activité politique des Algériens en France. Il faut que leur action politique s’effectue au grand jour, avec des organisations légales, donc contrôlables, avec des journaux que l’on puisse lire. Nous devons leur laisser d’autres moyens que ceux du désespoir.
Monsieur le Préfet, cela suppose que vous, vous changiez d’attitude. Ici je suis obligé de vous poser une question très grave. Je vous prie, non pas de m’en excuser, car vous ne m’en excuserez pas, mais de comprendre qu’il est difficile, pour un journaliste qui sait que son journal sera saisi, si quoi que ce soit déplaît un peu trop à la Police ou au gouvernement, d’écrire un article sur ce sujet. Mais quand ce journaliste est conseiller municipal, il a la possibilité de venir dire ces choses à la tribune et de les dire sans ambages.
Voici ma question : est-il vrai qu’au mois de septembre et d’octobre, parlant à des membres de la Police parisienne, vous ayez affirmé à plusieurs reprises que le ministre de la Justice avait été changé, que la Police était maintenant couverte, et que vous aviez l’appui du gouvernement ? Si c’était vrai, cela expliquerait, en grande partie, l’attitude de la Police au cours de ces derniers jours. Si ce n’est pas vrai, tant mieux. De toute façon, d’ici quelques années, d’ici quelques mois, quelques semaines peut-être, tout se saura, et on verra qui avait raison. Et si j’avais eu tort aujourd’hui, je serais le premier à m’en féliciter.

Notes
[1] France-Observateur, 2 novembre 1961.
Repris dans Claude Bourdet, Mes batailles, Editions In Fine, 1993 – pp.161-167
et dans Gilles Manceron, Le 17 octobre 1961 par les textes de l’époque, éd. …Petits matins, octobre 2011, diffusion Seuil, 5€.
[2] L’Union générale des travailleurs algériens a été fondée le 24 février 1956, dans la mouvance du Front de libération nationale NDE.
http://ldh-toulon.net/Claude-Bourdet-est-il-vrai.html


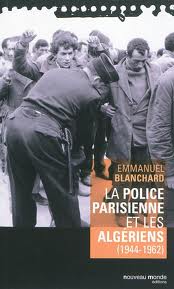
Aucun commentaire jusqu'à présent.