La joie venait toujours après la peine, de Michel Weckel
Les éditions Jérôme Do Bentzinger ont publié un livre de Michel Weckel au titre emprunté à un poème célèbre de Guillaume Apollinaire, La joie venait toujours après la peine.
D’une couverture noire, très chic, ressort la photographie d’une sculpture de Canova « Psychè ranimée par le baiser de l’amour ».
Le livre a un peu moins de 130 pages, et coûte 19 €.
On connaît un peu Michel Weckel, moins que son psychanalyste, certes, puisqu’il en est pas mal question, et que le livre est comme une sortie d’analyse. On le croise sur le terrain des religions, puisqu’il s’occupe actuellement d’inter-religieux à Strasbourg. On sait qu’il a travaillé longtemps à la Cimade, et qu’il est très préoccupé de la situation en Palestine. Il est proche aussi des réseaux militants qui luttent pour la défense des sans-papiers, et en ce moment, il diffuse à un carnet d’adresses de plusieurs centaines de noms, la bonne parole, que parfois on reprend dans la Feuille de Chou. On l’a entendu très récemment au Club III de la Communauté juive de Strasbourg où il a été question (très prudemment sur le fond) de dépassionner le sujet brûlant du conflit palestinien, tâche difficile s’il en est.
Son livre lui ressemble: il se livre sans se livrer. C’est un constat, pas un reproche, car il y a des limites à ce qui peut se dire du privé dans le public.
Il est composé de 22 chapitres, de longueur très variable, certains d’une seule page, et quelques uns empruntent la forme d’une prose poétique.
On ne s’étonnera pas que l’un des sujets principaux soit le religieux dans lequel il trie soigneusement celui, irrationnel et dangereux des intégrismes, quels qu’ils soient, et le « rationnel ».
On peut le suivre, sauf que, dans ce rationnel, résident tout de même des noyaux fondamentaux d’irrationnel.
On n’est pas certain comme lui et les médias que le 21e siècle soit si religieux que cela. Mettre le projecteur sur des minorités ultra-agissantes les grossit inévitablement. Il n’oublie pas la religion dominante de la marchandise, dont les lieux « saints », les fidèles et les prêtres sont les plus nombreux.
En passant, signalons que Malraux n’aurait pas dit que le siècle sera religieux, mais spirituel, ce qui n’est pas la même chose.
On partage l’idée que ce qui est à craindre ce n’est pas le vide, mais le trop plein de la Vérité (toujours phallique), quelle qu’elle soit. Tout ce qui comble le trou est prélude au totalitarisme.
Leçon d’analysant. Donc, vive « la parole singulière » de chacun(e) et le « sujet de l’inconscient ».
Le premier chapitre est pour les éventuels néophytes, une petite initiation à la psychanalyse. On y entend que ça, nous échappe. Détresse et désir.
Le chapitre 2 est l’un des rares, comme le 3, à ne pas être écrit à la première personne. Il s’agit comme le dit une note page 31 d’un récit inspiré d’une scène du film « Il faut sauver le soldat Ryan » -je ne l’ai pas vu- où une mère va apprendre la mort d’un fils. On n’en dira pas plus, pour respecter le retrait de l’auteur. A chacun ses deuils.
Le chapitre 3 est à la troisième personne et encore sous le signe de la perte, de la séparation, du deuil, suite à « la mort accidentelle de sa femme ». On y frôle, comme Montaigne et Rousseau, la mort accidentelle. Et la résilience fait son œuvre, avec la psychanalyse.
Paul Eluard est convoqué sur la disparition de sa femme Nush. Henri Michaux pour celle de Lou. « L’encre est un baume ». Claude Vigée, également que j’avais aussi entendu à la librairie Kléber.
On aurait pu y trouver aussi Quelque chose noir, de Jacques Roubaud, pour la même expérience de la perte.
De la mort à l’idée de Dieu, son « signifiant », au moins, il n’y a qu’un pas, semble-t-il. Mais pas de ce Dieu de certitude. Plutôt, une « case vide » à l’usage de sa fille. Toujours échapper au plein, au comblement, pour ménager une liberté, au sens de ce qui est nécessaire à un mécanisme, mais n’est pas mécanique. Du jeu, en somme.
Si la foi est une certitude, il se voit plutôt en « agnostique ». Mais, ajoute-t-il, aussitôt, il ne parvient « pas à imaginer une humanité sans religion. » Manque d’imagination? Suit un bref chapitre, fort, sur la frérocité, après Richard Freymann et Charlotte Herfray. Il est question aussi du vernis civilisationnel, si fragile, dont parlent Freud, et Norbert Elias et Nietzsche.
A Béthléem, lieu chaud s’il en est, il se demande « comment vivre avec le frère? » En attendant une réponse éventuelle, on se tue. L’auteur est très discret, comme lors de son intervention au Club III, sur l’oppression. Il est invité ce soir, par le Bnaï Brith, à la Communauté juive, pour ce livre.
« Ne pas céder sur son désir », nous apprend l’analyse. Ce qui n’est pas la même chose que ne pas céder (ou céder) à son désir, bien sûr.
Suit une réflexion sur le temps, sur ceux qui n’ont pas le temps, ceux qui en manquent, ceux qui en jouissent, qui prennent leur temps, le ralentissent, le perdent pourquoi pas. Et une remarque sur l’usage féminin du temps, qui semble différent. Mais faut-il rattacher cela à une sorte d’essence de la femme, comme liée à « rythme des menstruations, grossesses, ménopause… » Les féministes apprécieront…
Quant au « sens de la vie », en moins d’une page, il l’expédie, à juste titre, comme question oiseuse, « tu parles!
Juger, penser par soi-même, rien d’étonnant chez un protestant. Et la méfiance, peut-être exagérée, pour un vivre (ou agir)-ensemble, à l’égard des foules, du collectif, comme si on ne pouvait rester soi-même, individu, au sein d’un groupe. Il y a des œuvres et des tâches qu’on ne peut accomplir seul. Mais il « préfère payer le prix d’une certaine solitude ». « Poor lonesome cow-boy »?
Un des chapitres les plus longs, porte sur l’origine de nos pensées. Pourquoi ce moment de printemps fait-il songer à la mort? Il cite le beau titre d’un livre d’une théologienne suisse, Es gibt ein Leben vor dem Tod. Il y a une vie avant la mort. En effet, tandis qu’ après…Mais là c’est moi qui l’ajoute.
Comme dans une sagesse asiatique, -voir François Cheng- « il faut admettre que l’essentiel ne se décide pas ». Suit une belle page sur la vérité, « un blanc entre les lignes », du même ordre que la case vide de « l’absence de Dieu ». Mais a-t-il jamais été présent?
Au moins les « grains de sable » de la Baltique, retrouvés au fond d’une poche, sa madeleine à lui, sont-ils réels. Comme le présent ou l’émotion sur une dune de sable du Sahara. Le livre va vers sa fin, avec un éloge de la marche, des savoirs pratiques perdus « tuer de ses mains un lapin »…
Chose qu’aucun juif (pratiquant) ne fera…car cet animal ne se mange pas.
Les rêves, les insomnies le conduisent à Celan, et à son « lait noir de l’aube », « Schwarze Milch der Frühe ». Et à la rencontre, d’un vieil homme avec l’enfant qu’il fut. Enfin une déclaration d’Ingmar Bergmann lui permet de revenir, sur la responsabilité d’un certain luthéranisme dans l’avènement du nazisme.
Comme une dette impayée.
J. C Meyer
12 mai 2011

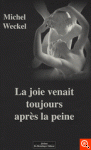
Comprendre : plus de 130 pages serait rédhibitoire !
tu veux aussi le prix?
19 €
” Le livre a un peu moins de 130 pages ” : pourquoi préciser le nombre de pages? C’est drôle…
nervotov et jim mauricette c’est kif-kif bourricot: vous prenez les gens pour des crétins?
C’ est exactement ce que disait mr nervotov. Sans avoir a se référer a Wikipédia !
Penser , argumenter , ne sont pas copier coller..
lisez sur Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Des_Juifs_et_leurs_mensonges
Alors, vous nous expliquez professeur?
Et bien expliquez nous alors monsieur le professeur !
Pour les ignorants comme Ohen, si toutefois il devait en faire partie je me permets de déposer ici ce magnifique poème dont il est question ci dessus :
Lait noir de l’aube nous le buvons le soir / le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit / nous buvons et buvons / nous creusons dans le ciel une tombe où l’on n’est pas serré / Un homme habite la maison il joue avec les serpents il écrit / il écrit quand il va faire noir en Allemagne Margarete tes cheveux d’or / écrit ces mots s’avance sur le seuil et les étoiles tressaillent il siffle ses grands chiens / il siffle il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe / il nous commande allons jouez pour qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit / te buvons le matin puis à midi nous te buvons le soir / nous buvons et buvons / Un homme habite la maison il joue avec les serpents il écrit / il écrit quand il va faire noir en Allemagne Margarete tes cheveux d’or / Tes cheveux cendre Sulamith nous creusons dans le ciel une tombe où l’on n’est pas serré
Il crie enfoncez plus vos bêches dans la terre vous autres et vous chantez jouez / il attrape le fer à sa centure il le brandit ses yeux sont bleus / enfoncez plus les bêches vous autres et vous jouez encore pour qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit / te buvons à midi et le matin nous te buvons le soir / nous buvons et buvons / un homme habite la maison Margarete tes cheveux d’or / tes cheveux cendre Sulamith il joue avec les serpents
Il crie jouez plus douce la mort la mort est un maître d’Allemagne / il crie plus sombres les archets et votre fumée montera vers le ciel / vous aurez une tombe alors dans les nuages où l’on n’est pas serré
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit / te buvons à midi la mort est un maître d’Allemagne / nous te buvons le soir et le matin nous buvons et buvons / la mort est un maître d’Allemagne son oeil est bleu / il t’atteint d’une balle de plomb il ne te manque pas / un homme habite la maison Margarete tes cheveux d’or / il lance ses grands chiens sur nous il nous offre une tombe dans le ciel / il joue les serpents et rêve la mort est un maître d’Allemagne
tes cheveux d’or Margarete / tes cheveux cendre Sulamith
quelle ignorance!
Avec des gens comme vous qui n’ ont de cesse que de jeter de l’ huile sur le feu, dépassionner le conflit israélo palestinien s’ avère difficille !
Pouvez vous développer votre analyse et nous expliquer en quoi le luthéranisme porte sa responsabilité dans l’ avènement du nazie ? Il est évident qu’ il porte une responsabilité dans celle de l ‘ antisémitisme moderne ! J’ ai bien dit antisémitisme, pas antijudaisme !